À la Fédération Ouvrière Régionale Argentine
Compagnons travailleurs,
Salut. Sans espoir, résigné, enfermé et affaibli, mais courageux, j’attendais tranquillement dans ma grande et silencieuse réclusion, entre quatre murs, sans voir la lumière du jour, sans pouvoir parler à personne, j’attendais tranquillement et avec fermeté la mort. D’autres reclus, ne pouvant pas résister aux cruelles persécutions, se sont pendus ; d’autres sont morts anémiques, tuberculeux ; gardez présent compagnons, que celui qui entrait «à perpétuité», on lui interdisait la lecture, le courrier ; il ne pouvait ni fumer, ni même prendre un maté amer et il n’avait le droit qu’à une demie ration de nourriture. Moi, j’avais quelques livres dans la cellule et quand ils le surent, ils me les enlevèrent et laissèrent passer la lumière par la porte et la fenêtre ; je n’avais pu lire les livres faute de lumière. Mais ils ne se contentèrent pas de me rationner et de me mettre à l’isolement strict ; ils inventèrent, ils cherchèrent des prétextes et ainsi, ils venaient chaque deux ou trois jours, quatre ou cinq gardiens dirigés par Sampedro, ils m’emmenaient au cachot et m’obligeaient à me déshabiller complètement pour me fouiller. Plusieurs fois, étant fiévreux, je refusais de me déshabiller ; alors ils me menaçaient par la force. Et dans ma cellule, qu’est ce qu’ils ne faisaient pas ! Ils retournaient et cassaient tout ; ils m’enlevaient ce que mon père m’envoyait, et quand il n’y avait plus rien à me prendre Sampedro me retirait la pipette pour boire le maté. C’était vraiment curieux de voir les inspections ; chaque gardien semblait prendre une grande satisfaction à emporter quelque chose ; ils emportèrent jusqu’à mes médicaments et pour les prendre, je frappais à la porte et le gardien me les donnait, revenant me les enlever tout de suite. Je les réclamais et on me répondait de les réclamer aux supérieurs. Pour l’anniversaire de mon évasion, un groupe de musique avait joué sous ma fenêtre de 8 heures à 11 heures du matin ; ainsi que l’après-midi de 13 heures à 18 heures ; eux s’amusaient à me rappeler la date de mon échec. Ces trente hommes avec un chef d’orchestre croyaient me déranger, me faire souffrir, mais moi je riais de la perversité de mes bourreaux. Par manque d’aliment, par manque d’assistance médicale (à ce moment, ils interdisaient au médecin Izaza l’entrée du bagne parce qu’il protestait contre l’usage abusif du cachot), par manque d’air et de lumière, je suis malade. J’ai sollicité l’infirmier et pour le faire venir, j’ai du crier de la fenêtre mais les gardiens n’ont pas prévenu la garde et se sont excusés en disant qu’ils avaient oublié. Mes bourreaux, en fermant la porte, après l’inspection, parlaient à voix haute pour que je les entende : «Celui-là ne veut pas mourir, il est malade, il ne mange pas, il est mou et il n’a pas envie de se pendre». Un jour, comme je ne mangeai pas de viande ni de plat, je demandai s’ils me donneraient une assiette de soupe de malade et le gardien me répondit : « Ils te donneront plus vite une corde qu’une soupe [jeu de mot entre soga et sopa] ». Par pure curiosité, un jour, quelques officiers d’un navire demandèrent à me voir et quand ils ouvrirent la porte… ils frémirent à la vue de l’état dans lequel je me trouvais. Un officier inconsciemment, me demanda si j’étais au pain sec et à l’eau et le gardien répondit que je ne voulais pas manger. Je leur dis qu’il y avait plus d’une année que j’étais en demande qu’on me donne pour seule nourriture une assiette de soupe et que je me maintenais… moralement. Alors, Miguel Rocha, un chef de l’administration pénitentiaire, ordonna qu’on me donne la maudite soupe avec des pommes de terre : après quelques jours, on me la retira. Mais cela n’est rien ! Quand le navire école arriva, le médecin à bord fit quelques visites ; j’en ai demandé une et après quelques requêtes ils amenèrent le médecin accompagné de quatre surveillants, par crainte de ce qu’il dirait de l’état dans lequel il me trouverait. Quand je lui dis qu’il y avait deux ans que j’étais reclus sans sortir de la cellule, je ne pus parler d’avantage parce que le chef des surveillants fourra son nez dans la conversation et le médecin se retira. Ensuite, j’ai demandé qu’on m’examine ; ils me frappèrent et sous les regards inquisiteurs des gardes, le médecin s’acquitta de sa mission humanitaire en confirmant que j’étais atteint d’une inflammation chronique de la gorge et d’une insuffisance pulmonaire. Il me prescrit un bon remède mais une fois le navire partit, ils ne voulurent pas me donner le médicament ni me soigner, et la maladie continua son cours. Dans le quart de cellule du pavillon 5, où je me trouve, il y avait un autre reclus, dans les mêmes conditions, le compagnon Avelino Alarcon [un anarcho-syndicaliste membre du syndicat des boulangers], qui reçut quinze jours de cachot au pain sec et à l’eau pour être un de mes amis intime et anarchiste. Palacios le fit condamner à sa sortie du cachot. En peu de temps, il tomba malade. Un jour, il envoya une lettre à l’administration demandant l’assistance médicale et ils lui répondirent de se diriger vers le directeur. En même temps, Miguel Rocha ordonna qu’il ne lui soit donné ni papier ni crayon et que ne soit permis à aucun détenu d’envoyer quelque lettre que ce soit sans qu’il en ait pris connaissance, excepté au directeur ou à la famille. L’état d’Alarcon s’aggravait chaque jour d’avantage. Plusieurs fois, j’ai appelé l’infirmier et lui ait demandé que lui soit donné quelques médicaments pour qu’il puisse résister jusqu’à l’arrivée du médecin de Buenos Aires au bagne. On m’a répondu que je n’avais qu’à aller parler avec Palacios, et ainsi, semaines et mois passèrent. Un jour, j’ai obtenu un peu d’huile, du sucre, du thé et du lait concentré ; j’ai demandé au gardien s’il voulait me faire la faveur de donner cela à Alarcon, mais il refusa et quand ils vinrent m’inspecter, j’osai le demander à Sampedro et au chef de service, Gonzalez ; je les priai, et m’humiliai devant ces deux hyènes, mais assurément, il est plus facile d’attendrir une pierre que les cœurs de ces bêtes ; je leur dis que le sucre était à moi, que lui ne mangeait rien et ils me répondirent : «Quand il aura faim il mangera». Peu de jours après, à force d’insistance avec les gardiens, j’obtins qu’ils lui portent quelques vivres. Alarcon pleura, il connaissait le sacrifice que j’avais du faire pour pouvoir l’aider en quelque chose. Je demandais toujours au gardien comment allait Alarcon (certaines fois, la nuit, je parlais avec lui, quelques mots lors d’un instant d’inattention des gardes, mais ils nous dénoncèrent et la direction ordonna de punir de 15 jours au pain sec et à l’eau ceux qui parleraient) ; certains disaient la vérité, d’autres mentaient. Un jour, à l’heure du repas, quand ils ouvrirent la cellule d’Alarcon, je remarquai un grand silence ; après qu’ils aient distribué la nourriture, j’appelai le garde et lui demandai qu’il me dise la vérité sur l’état d’Alarcon. Il me dit que c’était très grave. Je demandai au garde X qu’il avise l’infirmier ; peu de temps après, l’infirmier vint et dit au garde : «C’est grave, mais je dois consulter G. N. Palacios et M. Rocha». Quand il leur dit qu’il était nécessaire de le mettre en isolement, Rocha et Palacios lui demandèrent s’il était sûr que Alarcon «allait mourir», et avant l’affirmation de l’infirmier, ils donnèrent l’ordre de le transférer en isolement. À six heures de l’après-midi, j’entendis les gardiens parler de le transporter ; je frappai à la porte, les gardiens m’ouvrirent ; presque à bout de force j’arrivai à la cellule d’Alarcon ; ils ne voulaient pas ouvrir la porte ; je leur dis : «et bien, au lieu de porter un cadavre vous en porterez deux». Ils ouvrirent enfin… quand il me vit, il fit un effort surhumain pour se lever. C’était un squelette, mes frères… Il me dit : «Ma mort s’approche ; je meurs tranquille, j’ai lutté pour notre idéal, pour le bien des travailleurs, j’ai toujours été loyal avec mes amis et juste dans ma conduite». Les gardiens qui étaient présents ne pouvaient retenir leurs larmes à voir s’embrasser deux victimes de la société actuelle. Par crainte que quelqu’un nous vît, car ils seraient jetés à la rue, les gardiens ne me laissèrent pas plus d’une minute. Peu de jours après, le 15 septembre, Alarcon mourut à l’isolement. Compagnons : vous pouvez imaginer quel a été mon état en voyant mourir à mes côtés un compagnon, un frère, et ne pouvant l’aider ni soulager son martyr. Peu de temps après, ils tueront de la même manière le prisonnier numéro 452 (Carlos Barrera). Celui-ci eut un échange de mots avec quelques gardiens ; ils le battirent et le mirent au cachot avec ordre de le garder au pain sec et à l’eau ; ensuite, ils lui ramenèrent un matelas et lui donnèrent une demie ration de nourriture, le laissant reclus. Quelques mois après, en raison de l’enfermement et des blessures reçues en luttant contre les gardiens, il tomba malade. Il demanda l’assistance médicale et on lui répondit : «tu es un vaurien, tu fais le malade pour qu’on lève ta réclusion». La douleur l’obligeait à se plaindre et, un jour, ignorant qui se plaignait, je le demandai au gardien. Il me dit «c’est le 452 qui fait le fou pour que sa peine soit levée». Je leur démontrai qu’il était trop humain pour faire semblant d’être malade et qu’ils l’avaient fait voir, tout au plus, à un infirmier mais il me répondit que le chef de service, Gonzalez, lui avait dit de se soigner tout seul. Ainsi, peu à peu, il perdit la raison ; il chantait, il sifflait. Une nuit je l’appelais et lui dis : «Compagnon, rends moi ce service, si cela est possible, de ne plus siffler la nuit car je suis aussi alité et malade» et il me répondit : «Frère, pardonne moi, je ne peux pas, ils m’ont empoisonné et il reprit ses plaintes : aïe ! … aïe !» Comme il se plaignait beaucoup, jour et nuit, le chef de la sécurité, Gonzalez, alla à la direction dire qu’un détenu faisait le fou et le malade, et Palacios et Rocha ordonnèrent (ainsi me le dit le gardien) : «laissez-le au pain sec et à l’eau, nous lui ferons passer sa folie». Ce fut ainsi jusqu’à ce qu’un jour le gardien dise à la garde «Il paraît que le 452 va mal». Le chef de service vint pour confirmer que c’était vrai et au même moment l’infirmier arriva. Celui-ci, après l’avoir vu, alla à la direction où on lui posa la même question que lorsque Avelino Alarcon était moribond, s’il était sûr qu’il allait mourir. Ils apportèrent la civière, l’emmenèrent à l’infirmerie et le jour suivant il mourut… en demandant de l’eau. Compagnons : l’émotion ne me laisse pas écrire ; je me rappelle tout ce que j’ai vu ces dix dernières années au bagne, des quelques six années passées dans les cachots, avec 20 ou 30 jours au pain sec et à l’eau, à l’isolement et avec, clouée à la fenêtre, une plaque avec des trous dans lesquels une allumette passerait à peine, écoutant les cris à côtés de moi «Ne me frappez plus s’il vous plaît, un peu d’eau». Et en hiver, les prisonniers sans vêtements aux cachots, ne pouvant résister au froid, demandaient qu’on les tue d’une balle, que ce serait plus humain. Peu de temps après que le prisonnier 452 soit mort (Carlos Barrera), le 122 se pendit. J’ignore comment il s’appelait ; il était aussi à l’isolement. Quelques semaines après, à force de trop de cachot, pendant trente jours au pain sec et à l’eau, ils tuèrent le 629. Un tuberculeux (Lastra, 450) mourut aussi. Un jour, à l’heure de l’inspection, un gardien me dit : «Attention avec les draps déchirés». Je lui demandai pourquoi il me disait cela et il me répondit, avec le sourire aux lèvres, qu’à l’heure de donner le café au détenu 632, ils l’avaient trouvé pendu avec un morceau de drap. «Eh, fais bien attention à ne pas déchirer les draps !» J’étais au lit, malade ; je ne pouvais pas me lever ; je l’ai insulté et j’ai eu la force de lui tirer le pot de chambre (zambullo) à la gueule. Je l’ai insulté, chassé… Pour eux, c’était un plaisir, vu que je m’affaiblissais, me consumais dans un cachot, ils venaient chaque jour me mortifier plus. Soudain, un jour, un gardien vint et me demanda si je connaissais le prisonnier 35, Luis Burgatto ; je répondis que je n’avais de compte à lui rendre sur rien. Alors il me dit : «il paraît qu’il devient fou». À l’entendre, je tressaillis. Cela faisait déjà plusieurs nuits que j’en entendais un parler tout seul. Que n’ont-ils pas fait avec lui ! Trois jours au pain sec et à l’eau en guise d’interrogatoire ; trente jours pour avoir touché un pain de contrebande lors d’une punition au cachot ! ; long enfermement, demi-ration de nourriture, des cris «Ne me cognez pas» qui sortent des cachots, les soupirs des malades, tout cela a eu une influence sur lui et lui fit perdre la raison. Une fois qu’il criait qu’il voulait parler au chef, ils le changèrent de cellule parce que sa fenêtre était en face de la garde et ils le mirent en face de la mienne. La plus grande partie des journées, ils le laissaient sans manger parce qu’il criait : «ça fait deux ans que je suis enfermé ; gars, gars, je suis innocent… ils m’ont empoisonné… chef !» Sur ordre du chef de service, Gonzalez, ils le laissèrent, un jour, non seulement sans nourriture, mais aussi sans eau et avec des planches clouées à la porte. Le prisonnier 35 se déchaîna et avec les planches de la couchette, commença à frapper sur la porte. J’appelai le gardien et le priai qu’il lui donne ma ration de pain et de nourriture pour l’apaiser, vu qu’il était malade de l’esprit. Il me répondit qu’il n’était pas malade, qu’il simulait. Les gardiens venaient pour se divertir avec lui et quand la nuit arrivait, Sampedro et son escadron l’emmenaient au cachot. Lui alors, voyant beaucoup de gardiens, refusait de sortir de sa cellule et criait : «Tuez moi, tuez moi…». Sampedro disait : «Je m’en fous, si tu n’y vas pas, nous t’emmènerons en te traînant par les pieds». Le malade, en entendant cela, saisit une planche et cria : «Celui qui entre, je lui casse la tête ; à l’aide ! à l’aide !» Compagnons : en face de ma cellule, un être humain a été assassiné… je ne pouvais plus supporter, je frappai à la porte, j’appelai les gardiens, je leur expliquai que s’ils lui donnaient de la nourriture, il se tiendrait tranquille ; qu’il était malade et qu’en plus, ils le laissaient sans manger quatre ou cinq jours par semaine, et qu’ainsi, forcément n’importe quel homme deviendrait furieux. Ils me répondirent de ne me soucier de rien et fermèrent ma porte. Vu qu’il ne voulait pas aller au cachot et que ses bourreaux craignaient qu’il leur casse la tête, ils firent ce qui suit : Au bagne, il y a un garde, Miguel Bolano ; cet homme était respecté par les prisonniers ; ils l’appelèrent (tout ce que je raconte, je l’ai entendu de mes propres oreilles) et Sampedro dit : «Essayons de le changer de cellule pour lui enlever les planches et après nous lui donnerons un matelas et de la nourriture». Le gardien Bolano s’approcha de la porte et il lui dit ceci : «Écoute Bugatto, comment va l’ami ? Aujourd’hui, ils t’ont laissé sans nourriture mais viens avec moi, nous changerons de cellule parce que celle-ci a la porte cassée», mais le malade refusa, disant qu’on le tuerait et prononçant quelques mots incompréhensibles. Le gardien insista : «Regarde, 35, tu sais qui je suis, je ne vais pas te tromper ; nous allons changer de cellule et après, je t’apporterais un matelas et de la nourriture ; je te donne ma parole d’homme». Le 35 le crut et alla dans l’autre cellule… qui était le cachot, et avant de se rendre compte où il était, ils fermèrent violemment la porte. Le garde Bolano revint à la cellule de Bugatto pour lui apporter le matelas et la nourriture, mais Sampedro l’appela pour qu’il retourne à la garde car il n’y avait personne. Ainsi, lâchement, ils trompèrent le gardien et le prisonnier. Ils gardèrent Bugatto deux jours à l’eau et cinq nuits sans couverture, et ensuite au pain sec et à l’eau jusqu’à ce qu’il ne puisse plus marcher. L’intention de la garde était de le faire mourir comme Alarcon et le 452, mais à cette période, un médecin de l’établissement arriva et un compagnon alla lui dire que dans le pavillon, il y avait un prisonnier gravement malade. Le médecin le visita. Il lui prescrivit des remèdes et ordonna qu’on lui donne un lit et un matelas mais eux, voulaient continuer le même traitement. Une semaine plus tard le médecin revint le voir parce qu’il continuait à crier la nuit : «Gars, pour ma mère… viens, où es-tu ?» Le jour qui suivit la visite du médecin, les bourreaux allèrent dans la cellule, le laissèrent au pain sec et à l’eau, sans matelas ni couverture. Comme il était alité, sans force pour marcher, ils lui donnèrent des coups de bâtons, lui prirent le matelas et les couvertures, les mirent dans la poubelle dans laquelle il urinait et il dut faire ses besoins au sol. La direction, pour éviter qu’un prisonnier puisse raconter cela au médecin, ordonna que les consultations se fassent en présence du chef de service, avec lui, ils étaient sûrs que personne ne se risquerait à parler de ce qui se passait dans le pavillon 5. Mais, alors que le médecin se trouvait à l’hôpital, un prisonnier de passage l’avisa que dans un cachot du pavillon 5, le prisonnier 35 était moribond. Le médecin revint ordonner qu’on lui donne nourriture, matelas et vêtements mais ses bourreaux voulaient en finir avec lui, et il lui donnèrent une demi-ration et un vêtement et récemment, quand la rumeur courut qu’une commission venait au bagne, ils lui donnèrent un matelas. Compagnons : gardez présent que ce que je vous dis dans cette lettre n’est qu’une partie de ce que je vis et entendis durant ces deux années enfermé dans le pavillon 5. Et les raclées dans les cachots, sous ma cellule, et entendre pleurer sous les coups et la faim ! Pour dire vrai, moi aussi, quand j’étais sain, la nourriture, la demie ration, je n’y touchais pas. Il y avait des nuits où la faim ne me laissait pas dormir. Et penser que sous ma cellule, il y avait les autres qui n’avaient même pas un peu d’eau, ni même un matelas… jetés au sol dans les nuits d’hiver… les soupirs, les cris ! C’était véritablement à devenir fou, et mes bourreaux, lorsqu’ils sortirent Bugatto, mirent dans la cellule un fou, le 406, qui à force d’enfermement, de cachot et de coups, perdit la raison et passa nuit et jour à répéter cette rengaine : «la vérité de mes vérités est pure vérité et les vérités que je dis sont de vraies vérités». Il m’était impossible de continuer ainsi, car je ne pouvais pas dormir à cause de ses «vérités» qu’il chantait à voix haute. Je demandai à changer de cellule. Ils me répondirent : «Ainsi, il se divertit et ne s’ennuie pas mais s’il veut, nous en rendrons compte à la direction». Savez-vous ce qu’ils firent ? Voyant que mon état s’aggravait, que je ne mangeais pas et que je dormais peu, toutes les nuits, à minuit et à quatre heures, ils ouvraient la porte de ma cellule et me réveillaient en disant : «ça va ?» Je demandais que l’on me laisse tranquille au moins la nuit et on me répondit que s’était l’ordre d’un supérieur de venir me voir deux fois par nuit par « crainte » que je ne me pende… et depuis plus d’un an, j’ai un fou en face de ma cellule qui me chante «la vérité de mes vérités», etc, etc. Mais ce n’est pas le même fou. Avant il y en avait un autre, mais un curieux ; il rêvait et délirait, il se réveillait en criant au secours et en m’appelant : «Simon, s’il te plaît, détache-moi le nerf qui m’a emmené en enfer et qui m’a attaché le cœur…» Il pleurait, il criait. Les gardiens, des stupides ! Venaient la nuit s’amuser avec lui ; il y en a un autre qui crie dans son délire qu’ils ont tué sa femme et ses enfants. À cet homme, un officier de police à Cordoba, déshonora une de ses filles et la mit dans une maison de prostitution. Lui, en l’apprenant, tua l’officier et fut condamné à 25 ans de bagne. Depuis qu’il était arrivé ici, il avait perdu la raison. Au début, comme d’habitude, ils disaient qu’il faisait le fou mais cela fait déjà trois ans qu’il est dément et que ne lui ont-ils pas fait ! C’est vraiment incompréhensible qu’il ne soit pas mort avec tous les mauvais traitements qu’il reçut. Il ne retrouvera plus jamais la raison. Je ne savais pas comment il s’appelait ; il a le numéro 273. Du 30 novembre 1918 jusqu’au 7 janvier 1921, je suis resté entre quatre murs, sans voir la lumière du jour et avec une demie ration. Et avec celle-là, je souffrais de quatre périodes d’isolement passées. La première fut de mars 1912 à octobre 1913, la seconde de février 1914 à décembre, et la troisième d’octobre 1915 jusqu’au 25 mai 1916. À chaque fois que je rentrais à l’isolement, j’avais d’abord vingt ou trente jours au pain sec et à l’eau ; après quand je travaillais je souffrais de ces enfermements. Le 3 janvier, à l’heure du repas, l’inspecteur de justice, docteur Victor Baron Peña se présenta dans ma cellule. Il me demanda comment je m’appelais. Je lui dit mon nom. Bien que je sache déjà qu’il était pour plus de sécurité, je lui demandai : «Êtes vous l’inspecteur de justice ?». «Oui». Je voulus parler mais il me dit qu’il allait d’abord manger et qu’il me parlerait le jour suivant. Ce fut ainsi. L’autre jour, pendant l’après-midi, la direction m’appela et je dus me confesser : j’avais à peine assez de force pour marcher et me tenir debout. L’inspecteur de justice dut me donner une chaise sur laquelle je m’assieds pour pouvoir parler. Je parlais, je parlais beaucoup ; je racontais tout ce que j’avais vu et souffert depuis le jour où j’étais arrivé au bagne ; tous les isolements, les cachots, les persécutions dont sont victimes les prisonniers. Il était très attentif : il me dit que tout changerait, qu’il viendrait avec une mission humanitaire faire justice. Je lui démontrais que lors des multiples interventions, les prisonniers avaient été bien traités lorsqu’elles arrivaient, et le jour qui suivait le départ des inspecteurs, en route vers la capitale, les vieux procédés reprenaient au bagne. Il m’assurait que cette fois ce ne serait pas ainsi et qu’ils suivraient les ordres qu’il donnerait ; que l’on traiterait les prisonniers humainement. Ensuite, les prisonniers défilèrent devant lui. Certains tombèrent en allant à la direction ; alors, l’inspecteur alla jusqu’aux cellules et là-bas, l’homme se trouva sans force pour contenir ses larmes, en écoutant un prisonnier, qui pour avoir demandé au chef de service, Gonzalez, qu’on le fasse soigner, étant malade, et pour l’avoir crié à la fenêtre, a pris 37 jours au pain sec et à l’eau (au moment où j’écris, il est moribond ; hier ils nous ont levé de l’isolement moi et un autre compagnon) ; et les souffrances inaudibles des autres qui devinrent fous par la faim et les raclées ; ceux qui sont depuis plus de deux ans sans chemise et d’autres (un fou qui l’a insulté) qui pour parler à la fenêtre souffrirent de trente jours au pain sec et à l’eau ou quand par plaisir Sampedro décidait de remplir les cachots. L’inspecteur est vraiment digne d’admiration ; compagnons : il fait honneur à la justice. Jusqu’à une heure du matin il allait de pavillon en pavillon et de cellule en cellule. Il suspendit Palacios et Rocha ; il renvoya six matons, et le 7 janvier, il leva de l’isolement tous les prisonniers du pavillon 5. Malheureusement pour moi et d’autres détenus, la porte s’ouvrait un peu tard. Mais au moins j’aurais une satisfaction en mourant, avoir vu un être humain et la lumière extérieure. Et l’inspecteur ne fit pas que cela, il était un homme, un homme d’honneur. Le jour où il parla avec moi, en m’en allant, je lui dis que s’il voulait des preuves des raclées que nous prenions au cachot, dans le pavillon où j’avais été enfermé il pouvait trouver les bâtons et une balle de sable ; je lui indiquait l’endroit où elles étaient cachées, il y alla, les trouva, et trouva encore plus. Ceux de la direction, c’est-à-dire Palacios et Rocha dirent que les bâtons étaient aux prisonniers (quand il trouva les bâtons, il se présenta au chef de la sécurité, José Muzzo, et quand l’inspecteur lui demanda pourquoi les bâtons étaient là, il ne sut rien répondre, il resta confondu) et que nous avions des armes à feu, des couteaux, des dagues, etc. Le jour suivant, l’inspecteur ordonna que tous les membres du personnel se présentent à trois heures du matin. Ils crurent que cela était un nouvel ordre ou une manœuvre quelconque. À trois heures, l’inspecteur se présenta et demanda à fouiller les cellules. La fouille dura de trois à neuf heures, effectuée en présence de l’inspecteur, et les uniques choses qu’ils trouvèrent furent des amadouviers… et des bouts de chaînes. L’inspecteur rit et demanda si ici les amadouviers [champignon utilisé comme bougie] étaient des armes à feu et les couteaux… des bouts de canettes que les détenus avaient pour couper leur viande. Alors ils comprirent que l’inspecteur n’était pas venu écouter le groupe de musique ni assister aux banquets. Certains prisonniers refusant d’aller travailler, la pression monta dans les pavillons avec les gardiens ; mais tous les détenus le comprirent et dénoncèrent à l’inspecteur que c’était les gardiens qui avaient fait naître les troubles pour que les prisonniers se révoltent ; tout ceci fut inutile car les prisonniers étaient unis et ils se conduisirent très bien durant leurs déclarations. Peu de jours après, une commission de quatre diplomates arriva par le croiseur San Martin. D’abord ils allèrent au pavillon 5. Arrivant à ma cellule, ils me demandèrent pourquoi j’étais tant persécuté au bagne. J’ai parlé plus de deux heures ; je leur appris tout, comme je le fais dans cette lettre, les châtiments, les isolements, etc, etc. Je ne pouvais plus parler, j’étais malade de la gorge et cela me coupait la voix. Ils allèrent dans les autres cellules et furent horrifiés de voir le reste des détenus. «Vraiment – diront-ils – la réputation dont jouit ce bagne est justifiée». Quand ils allèrent à l’isolement, presque tous les malades avaient été victimes du pavillon 5, ils écoutèrent, ne pouvant regarder les moribonds ni les tuberculeux crachant du sang.
Compagnons, travailleurs : Au nom de tous ceux que j’ai croisé au bagne, mes compagnons d’infortune, nous saluons et approuvons votre initiative contre les crimes de ce sombre bagne.
Simon Radowitzky
Bagne d’Ushuaïa, janvier 1921
PS : Maintenant le bagne fonctionne réglementairement, mais… hier, ils votèrent un nouveau règlement qui semble retourner vers l’ancien. Nous verrons. Pour clore ce sujet dont je vous parle dans cette lettre, ils ont fait cela : ils enlevèrent la fenêtre et comme le volet a la même taille, ils le clouèrent et le prisonnier dut alors supporter le vent gelé qui entrait par les 400 petits trous d’allumette… Dans cet état, l’inspecteur rencontra mon ami, à l’isolement, Enrique Arnold (165) [condamné en 1911 à 25 années de bagne pour le meurtre, qu’il nie, de Ester Naddeo avec qui il avait une aventure amoureuse secrète]. Le médecin, ensuite, prit soin de lui un mois sinon il serait mort. Ce détenu était malade et ils le persécutaient pour être un intellectuel et parce qu’il ne voulait pas vendre sa plume au major Grandon et à G. N. Palacios. C’est digne d’admiration que d’avoir souffert autant pour le bien-être des prisonniers.
Simon…


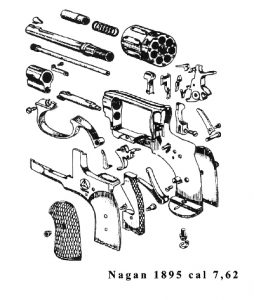 Compagnons ouvriers
Compagnons ouvriers
 «Compagnons anarchistes et travailleurs d’Argentine : Je suis libre. Je suis de nouveau un Homme parmi les Hommes. De mes 20 ans de souffrance et de résistance en tant qu’anarchiste dans cet horrible bagne argentin, maintenant, je vais pouvoir parler. C’est un accident banal dans la vie de tout révolutionnaire. Maintenant, je veux seulement dire, en guise de meilleures salutations, aux compagnons et prolétaires du monde entier, que mon anarchisme n’a pas reculé en prison, il s’affirme, aujourd’hui, plus fort que jamais, parce que je sais que ma liberté ne signifie pas la liberté du peuple, toujours esclave de la tyrannie de la bourgeoisie. Pour abolir, sur toute la terre, cette tyrannie, je serai toujours parmi vous. Ce n’est pas seulement vous que je veux saluer, mais aussi les compagnons qui sont toujours à Ushuaïa. Vous, travailleurs et anarchistes d’Argentine, prenez le comme une incitation à lutter contre les prisons et à libérer nos prisonniers. Ce salut va aussi à [Alexandro] Scarfo, [Manuel Gomez] Oliver, [Pedro] Mannina, Simplicho et Mariano de la Fuente, Desiderio Funes, les prisonniers de Avellaneda, Mariano Mur et tous ceux qui sont en prison et persécutés par les lois bourgeoises. Luttons pour eux ! Liberté pour eux ! Une embrassade de votre frère Simon Radowitzky. Montevideo, le 19 mai 1930.»
«Compagnons anarchistes et travailleurs d’Argentine : Je suis libre. Je suis de nouveau un Homme parmi les Hommes. De mes 20 ans de souffrance et de résistance en tant qu’anarchiste dans cet horrible bagne argentin, maintenant, je vais pouvoir parler. C’est un accident banal dans la vie de tout révolutionnaire. Maintenant, je veux seulement dire, en guise de meilleures salutations, aux compagnons et prolétaires du monde entier, que mon anarchisme n’a pas reculé en prison, il s’affirme, aujourd’hui, plus fort que jamais, parce que je sais que ma liberté ne signifie pas la liberté du peuple, toujours esclave de la tyrannie de la bourgeoisie. Pour abolir, sur toute la terre, cette tyrannie, je serai toujours parmi vous. Ce n’est pas seulement vous que je veux saluer, mais aussi les compagnons qui sont toujours à Ushuaïa. Vous, travailleurs et anarchistes d’Argentine, prenez le comme une incitation à lutter contre les prisons et à libérer nos prisonniers. Ce salut va aussi à [Alexandro] Scarfo, [Manuel Gomez] Oliver, [Pedro] Mannina, Simplicho et Mariano de la Fuente, Desiderio Funes, les prisonniers de Avellaneda, Mariano Mur et tous ceux qui sont en prison et persécutés par les lois bourgeoises. Luttons pour eux ! Liberté pour eux ! Une embrassade de votre frère Simon Radowitzky. Montevideo, le 19 mai 1930.»